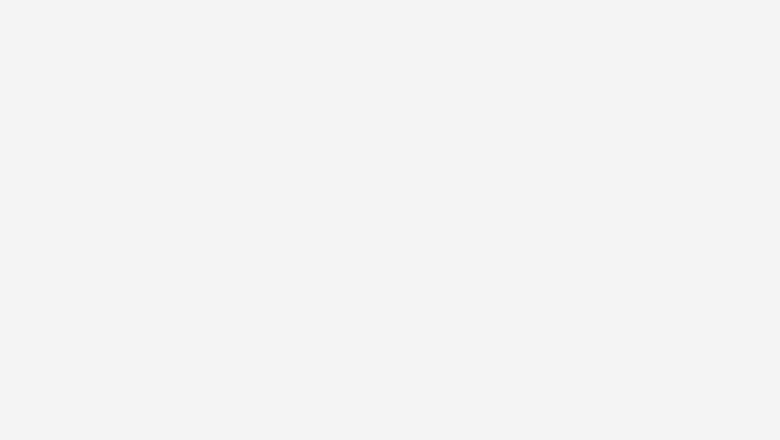Stigmatisant la violence à l’école, le roman de véronique Diarra nous fait découvrir une jeune femme talentueuse.
Véronique Diarra a mis au pied du mur le harcèlement en milieu scolaire, ce phénomène pervers quand bien même, selon les ethnologues, le bizutage est une consécration du passage de l’enfance à l’adolescence. Enseignante de carrière, elle occupe une position idéale d’où elle a observé ce qui se passe à l’école et comment ça dépasse l’autorité pédagogique souvent sourde et aveugle jusqu’au moment où surgit le drame. Le traitement littéraire qu’a fait V. Diarra de l’univers pédagogique est digne des travaux de l’école de Palo Alto. La plume de Diarra plonge le lecteur dans les profondeurs psychosociologique d’un collège chic de la banlieue parisienne où une élève, afrodescendante, est poussée à une « gestion honteuse de sa différence ». Les théoriciens de Palo Alto considèrent les rapports sociaux comme un réajustement permanent de nos différences et de nos ressemblances. Plutôt que chercher et rechercher le moteur de l’histoire dans les luttes de classe chères aux marxistes de la macrosociologie, le courant californien de Palo Alto, observe les choses tout en finesse, notamment en identifiant les luttes de classement des frontières qui sépare les individus. Pour les interactionnistes, le conflit commence lorsque le territoire de l’un interfère sur celui de l’autre.
Révoltée par la violence des rites d’intégration à l’école et écœurée par l’absence d’interaction du personnel de l’éducation, l’héroïne, Audrey Palenfo, élève en classe de 4ème se mure dans la soumission typique des victimes des harcèlements. Louis Gruel désigne par « gestion honteuse du stigmate négatif » cette attitude victimaire qui, de toute évidence, n’arrange jamais les choses. Dans son ouvrage, « Les rites d’interaction », Erving Goffman considère que l’accident social naît de la rencontre des bulles individuelles dont les agents sociaux ont du mal à classer les frontières. C’est aussi vrai pour chaque être que pour les Nations. Et, l’école demeure la grande bulle par excellence où les particularités culturelles ne cessent d’interagir. Deux élèves (des filles) l’une afro-descendante et solitaire (Audrey Palenfo), l’autre européenne de souche (Zoé Leporce ) et à la tête d’une bande de camarades autochtones affichent une tension que curieusement les adultes n’arrivent pas à palper. Dans un schéma input/ output, l’écriture de Véronique Diarra dégage cette vérité selon laquelle la soumission est un rite mis en abîme dans le silence de la victime et, surtout dans celui des témoins du harcèlement.
LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ
« Non, je ne me tairai plus » est un joyau littéraire qui fait briller l’intelligence d’une maman africaine. Mme Silué est une intellectuelle capable de défendre son territoire en dépit du stigmate aliénant de l’appartenance à une minorité dominée. La finesse littéraire de Diarra a consisté à éviter l’écueil du pathos alors que le roman porte sur une dimension plus ou moins visible dans l’école de la République, notamment le racisme dans les banlieues chics où la différence règne. Rompant avec la doxa, Véronique Diarra fait surgir in fine une figure antithétique de la discrimination : Laura, une héritière issue de l’élite intellectuelle, qui se lie d’amitié avec Audrey, Noire et fort-en-thème. Oui, l’école peut susciter des modèles d’amitié interethniques et interculturels.